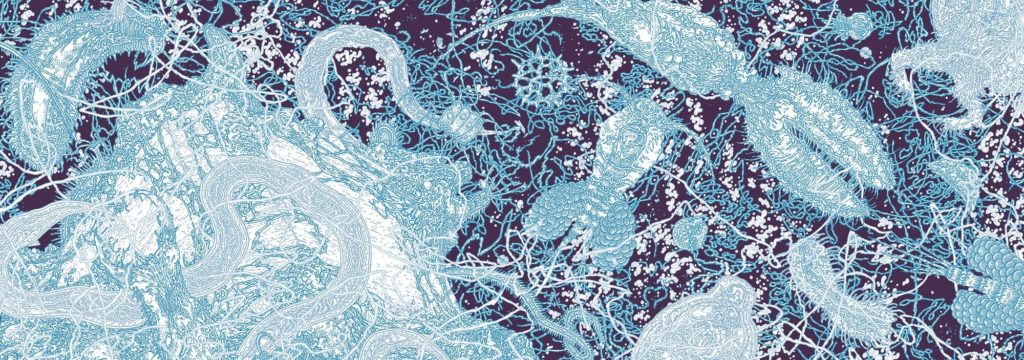Pour accompagner la sortie du rapport public « Loire Sentinelle : un fleuve, une santé », nous vous proposons deux entretiens inédits avec Lise Durantou et Vincent Prié. La première est spécialiste des microplastiques (son interview ici), le second de l’ADN environnemental (ADNe). Ensemble, iels nous rappellent que l’essentiel est souvent invisible pour les yeux.
―
Vincent Prié est hydrobiologiste et directeur de projets au sein du laboratoire Spygen. Spécialiste des mollusques d’eau douce, il s’intéresse à l’ADN environnemental (ADNe) depuis le début des années 2010, dans les rivières de France et d’ailleurs.
ADNe, VOIR LE PAYSAGE EN GRAND
DISCUSSION AVEC VINCENT PRIÉ
Loire Sentinelle : Pouvez-vous vous présenter votre activité.
Vincent Prié : Je suis hydrobiologiste, chercheur attaché au Muséum national d’histoire naturelle. Très jeune, à l’âge de 20 ans, je me suis passionné pour les mollusques d’eau douce, escargots et bivalves. Il y a beaucoup de littérature ancienne à leur sujet (Linné, Lamarck), mais très peu de spécialistes aujourd’hui. C’est tout le paradoxe.
D’une part, parce qu’ils sont difficiles à détecter – à trouver dans des eaux profondes, turbides… Et d’autre part, parce qu’on a du mal à les déterminer – à mettre un nom dessus. C’est là que l’ADNe entre en jeu.
L.S. Très concrètement, comment étudiez-vous les bivalves d’eau douce ?
V.P. Dans le cadre de ma thèse, en 2013, je me suis penché sur toutes les espèces de bivalves connues en France hexagonale – une soixantaine de noms à l’époque – pour clarifier leur taxonomie. Souvent, on part d’un vieux grimoire, d’un morceau de texte, où l’on espère trouver un indice qui nous guidera jusqu’à l’espèce et à sa rencontre lors de plongées. C’est un mélange d’enquête et d’exploration. Et c’est passionnant !
Quand j’ai commencé, j’étais quasiment le seul à faire ça, alors que la France est le pays avec la plus grande diversité de bivalves en Europe. Aujourd’hui, on dénombre ainsi 45 espèces de bivalves dans l’Hexagone et la génétique a largement contribué à dresser ce nouvel état des lieux.
L.S. Justement, quelle place a pris la technique de l’ADNe dans vos recherches ?
V.P. En 2011, quand je découvre l’existence de l’ADNe, c’est une petite révolution dans le champ de l’écologie et dans ma pratique personnelle. Car la méthode répond à la double difficulté posée par les mollusques d’eau douce : la détermination et la détection. Pour les bivalves par exemple, la probabilité de détection par ADNe est de 95 % contre 60 % environ en plongée.
Ce qui est vrai pour les bivalves ne l’est pas pour tous les animaux : on aura toujours du mal à détecter les reptiles et les crustacés, qui libèrent très peu d’ADN. Reste que je travaille de plus en plus avec cette technique. Ne pas le faire, ce serait comme demander à un ornithologue de travailler sans jumelles…
« Ne pas travailler avec l’ADNe, ce serait comme demander à un ornithologue de travailler sans jumelles. »
L.S. L’ADNe vient-il supplanter les méthodes traditionnelles ou la complémentarité des approches joue-t-elle réellement ?
V.P. En tout cas, je n’ai jamais autant plongé qu’aujourd’hui avec l’ADNe ! Plus sérieusement, cette technique, qui est considérée par certains naturalistes comme une « menace », ne se suffit pas à elle seule. La complémentarité des approches est donc fondamentale. Et pour plusieurs raisons.
Quand je détecte la présence d’une espèce avec l’ADNe, il est nécessaire de revenir sur le terrain pour préciser sa localisation, estimer sa population… Récemment, par exemple, on a révélé l’existence de trois espèces de moules d’eau douce menacées dans la Seine, à Paris : l’Anodonte comprimée, la Mulette des rivières et la Mulette épaisse, qui est protégée. Maintenant, il faut plonger pour savoir où elles se situent exactement et quels milieux préserver pour assurer leur sauvegarde.
Ensuite, parce que l’ADNe nous aide à sentir la présence de telle ou telle espèce, mais nous aurons toujours besoin des yeux des naturalistes et taxonomistes pour les observer, les décrire…
Enfin, dans une dimension plus poétique, l’ADNe interroge notre rapport charnel au vivant. Est-ce que je n’irai plus au contact des milieux que j’étudie parce que la génétique serait « suffisante » ? Pour moi, la réponse est non.
L.S. Cette complémentarité est donc nécessaire pour pallier les limites de l’ADNe ?
V.P. Notamment. L’ADNe n’est plus une technique émergente – on est déjà depuis un moment dans l’application très concrète – mais elle n’est pas encore stabilisée. Certaines limites actuelles peuvent être repoussées. Pour l’heure, les inventaires sont purement qualitatifs (présence ou absence d’une espèce). Mais avec le temps, pour chaque espèce, on devrait pouvoir estimer le nombre d’individus en fonction de la « puissance du signal » que l’on reçoit. Des progrès peuvent aussi être faits sur la distance de détection.
D’autres limites semblent indépassables : est-ce un individu sain ou malade ? Jeune ou adulte ? Etc. Mais quelle méthode n’a pas ses limites ? L’ADNe ne dit pas tout, mais il dit déjà beaucoup.
« C’est la première fois qu’on obtient une ‟photographie” d’un fleuve européen à cette échelle et avec autant de ‟pixels”. »
L.S. Que révèle cette technique de la santé d’un fleuve ou d’une rivière ?
V.P. L’ADNe permet de réaliser des inventaires de biodiversité à très large spectre. C’est la force de cette méthode : elle permet de regarder un paysage avec beaucoup plus de « pixels » que ceux habituellement perçus par nos yeux, nos oreilles… L’image est de bien meilleure qualité, plus précise, et donc plus juste pour mesurer l’état de santé d’un écosystème comme un fleuve ou une rivière.
L’ADNe a tout pour devenir un nouvel indice biologique de l’état des cours d’eau. En Guyane française, on vient par exemple de montrer une corrélation entre les sites où la plus grande diversité génétique s’exprime et les zones qui sont les mieux protégées le long du Maroni.
L.S. Et concernant la Loire ?
V.P. C’est la première fois qu’on obtient une « photographie » d’un fleuve européen à cette échelle, avec autant de données sur la biodiversité, des micro-organismes à la macrofaune. C’est d’autant plus intéressant que la Loire est un fleuve charnière, au croisement des influences continentale, ibérique et méditerranéenne.
Par exemple, et pour en revenir aux bivalves, je ne m’attendais pas à retrouver l’Anodonte comprimée ou la Mulette renflée en Loire. Ces résultats sont plus que prometteurs. Maintenant, il faut resserrer le maillage, avec plus de sites d’échantillonnage, et passer de l’inventaire au suivi à grande échelle.
L.S. L’ADNe peut-il devenir un outil de « veille citoyenne » ?
V.P. Je ne sais pas, mais nous recevons de plus en plus de demandes chez Spygen de la part d’individus ou de collectifs qui cherchent à mettre en évidence la biodiversité présente sur leur lieu de vie et/ou terrain de lutte. La méthode devient de plus en plus accessible (techniquement et financièrement), elle se démocratise, et suscite donc un intérêt croissant pour développer de nouvelles pratiques et répondre à de nouveaux enjeux.
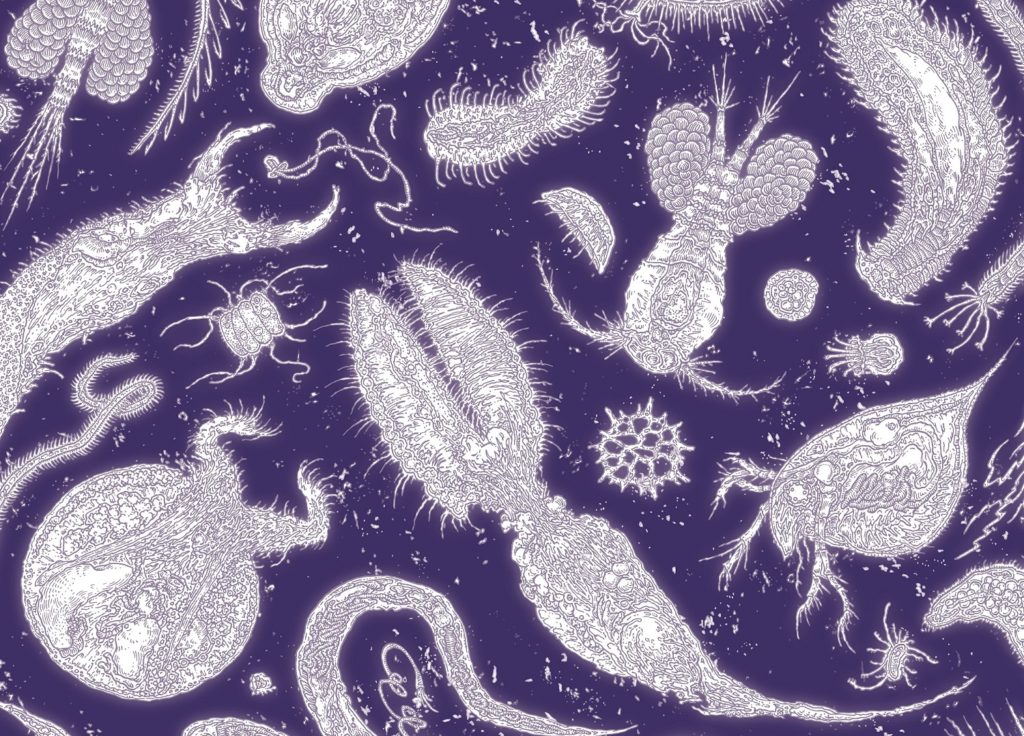
Micro-organismes – illustration de Clément Vuillier pour le rapport public Loire Sentinelle : un fleuve, une santé
―
Cet entretien est issu du rapport public « Loire Sentinelle : un fleuve, une santé » (p. 30-41)
Il est disponible en version numérique et interactive ici
ainsi qu’en version papier dans un ensemble de lieux partenaires (voir « Iels s’en font le relais »)