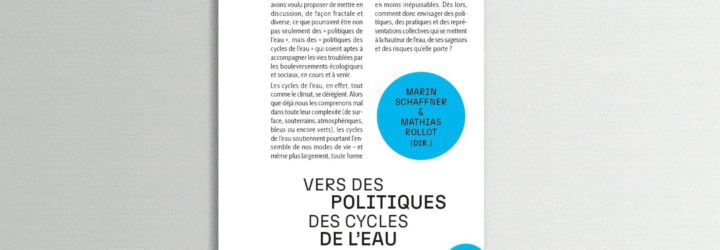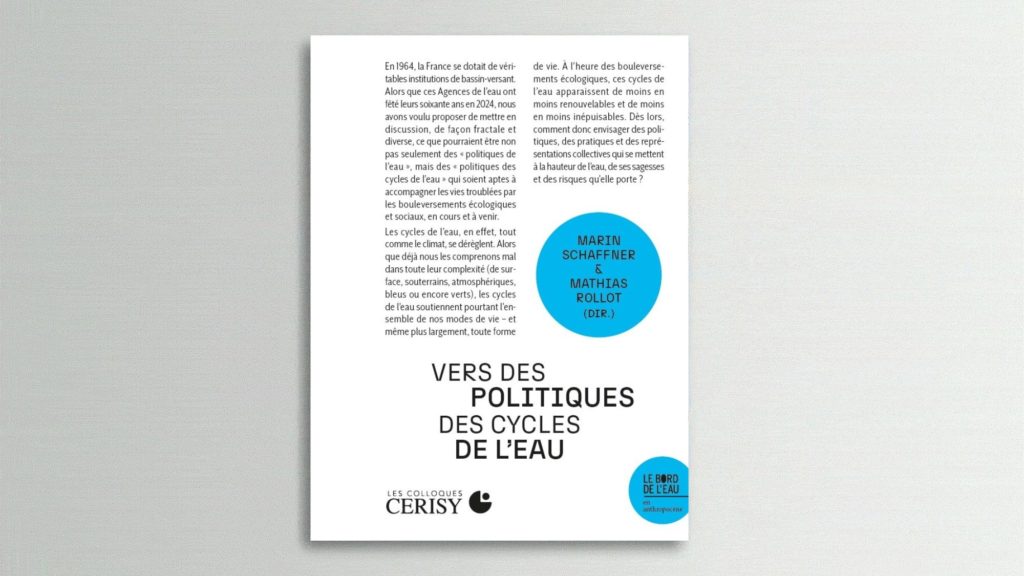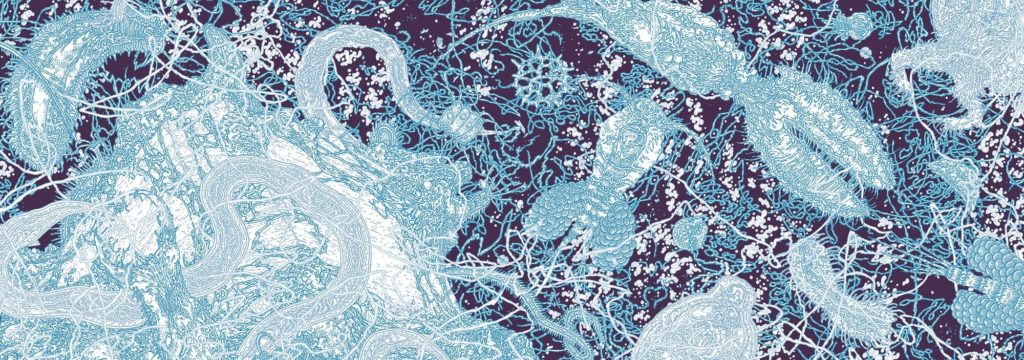« Vers des politiques des cycles de l’eau » est un ouvrage collectif paru aux éditions Le Bord de l’eau en jullet 2025. Il fait suite au colloque du même nom, qui s’est tenu à Cerisy en mai 2024, sous la direction de Matthias Rollot et Marin Schaffner, et auquel nous avons participé aux côtés d’Emma Haziza, Jérôme Gaillardet, Sophie Gosselin, David gé Bartoli, Jean-Louis Michelot et bien d’autres.
―
Au centre de cet ouvrage, une question : « que pourraient être des « politiques des cycles de l’eau » aptes à accompagner les vies troublées par les bouleversements écologiques et sociaux, en cours et à venir ? »
4e de couverture : « En 1964, la France se dotait de véritables institutions de bassin-versant. Alors que ces Agences de l’eau ont fêté leurs soixante ans en 2024, nous avons voulu proposer de mettre en discussion, de façon fractale et diverse, ce que pourraient être non pas seulement des « politiques de l’eau », mais des « politiques des cycles de l’eau » qui soient aptes à accompagner les vies troublées par les bouleversements écologiques et sociaux, en cours et à venir. Les cycles de l’eau, en effet, tout comme le climat, se dérèglent. Alors que déjà nous les comprenons mal dans toute leur complexité (de surface, souterrains, atmosphériques, bleus ou encore verts), les cycles de l’eau soutiennent pourtant l’ensemble de nos modes de vie – et même plus largement, toute forme de vie. À l’heure des bouleversements écologiques, ces cycles de l’eau apparaissent de moins en moins renouvelables et de moins en moins inépuisables. Dès lors, comment envisager des politiques, des pratiques et des représentations collectives qui se mettent à la hauteur de l’eau, de ses sagesses et des risques qu’elle porte ? »
➝ Couverture, sommaire et biographie des contribut·rices ici
➝ Lien vers la page du colloque ici
VERS DES POLITIQUES DES CYCLES DE L’EAU
ÉDITIONS LE BORD DE L’EAU / JUILLET 2025
Partie 4 : Nouvelles lignes de partage
B. Réthoré & J. Chapuis : « Il faut à la fois surveiller et veiller sur nos cours d’eau »
―
Extrait
―
Comment mobilisez-vous le terme « sentinelle », et en quoi peut-il être utile pour penser d’autres politiques des cycles de l’eau ?
En tant que biologistes, c’est par l’écologie scientifique que nous avons été exposé·es au terme de « sentinelle », et plus précisément à celui d’espèce sentinelle, qui caractérise une espèce dont la sensibilité à des variations, à des perturbations va rendre compte de l’évolution générale d’un milieu. On parle également de sentinelle écologique, d’espèce bioindicatrice, etc. Les notions sont voisines et procèdent de la même idée : ces espèces informent sur les milieux dans lesquelles elles vivent et sur les dangers qui les menacent. Par conséquent, elles jouent un rôle clef dans la surveillance des écosystèmes face à des modifications, des dégradations ou des destructions, qu’elles soient visibles ou invisibles. Par exemple, en ville, les lichens permettent depuis longtemps d’estimer les niveaux de pollution atmosphérique.
Avec le projet Loire Sentinelle, nous cherchons à élargir la notion de « sentinelle » aux milieux de vie et à le faire entrer dans le champ politique. La Loire, comme tant d’autres fleuves et rivières en France et dans le monde, fait face à des pressions de plus en plus soutenues et interconnectées : changements climatiques, prélèvements en eau, artificialisation, infrastructures lourdes, agriculture et élevage intensifs, pollutions… Mais plus qu’y faire face, elle y réagit, et ce faisant, agit comme un révélateur de nos manières d’habiter son bassin versant – de vivre au bénéfice ou au détriment de ses cycles. Dans cette optique, la Loire est une « sentinelle » : au travers de ses sécheresses estivales et crues hivernales, du réchauffement et de la pollution de ses eaux, de l’érosion de sa biodiversité, elle nous alerte sur les bouleversements en cours et à venir, nous aide à faire le diagnostic de notre monde, de nos rapports avec les autres et des futurs incertains*, et nous pousse à savoir contre qui et avec qui lutter.
À de plus petites échelles – peut-être plus saisissables et donc opérationnelles – comme celles d’une source, d’un ruisseau, d’une rivière ou d’une tourbière au creux d’une vallée, nous nous trouvons face à des milieux dont l’état de santé est mis à mal, qui présentent des symptômes et tentent, du mieux qu’ils le peuvent, de les soigner. Et nous autres humain·es, en tant qu’habitant·es préoccupé·es par l’état de santé de ces milieux meurtris, sommes d’une certaine manière des « sentinelles des sentinelles » – des sentinelles par extension – avec, selon nous, un double rôle à jouer : un rôle de vigie, qui est celui de surveiller ; et un rôle de gardien·ne, qui est celui de veiller sur ces écosystèmes.
En ce sens, et pour en revenir aux cycles de l’eau, les sentinelles seraient alors des personnes veillant, surveillant et défendant un cours d’eau, une forêt, un lac, un marais, des haies bocagères, etc. À l’image d’une « force tranquille » capable de s’activer ou de se désactiver selon les circonstances. Qu’importe les outils et les méthodes d’enquête mobilisées (scientifiques, journalistiques, habitantes), il s’agit de détecter des altérations précoces, d’alerter sur les menaces qui leur sont associées, et d’y répondre de la manière la plus efficace et pertinente possible pour les territoires et les cycles de l’eau dont ces sentinelles font partie.
[…]
―
Vers des politiques des cycles de l’eau / Juillet 2025 – 288 pages
Éditions Le Bord de l’eau – collection en Anthropocène
―
* Vinciane Despret, Le virus de l’imagination, préface du livre de Frédéric Keck, Les Sentinelles des Pandémies, Zones Sensibles, 2020.